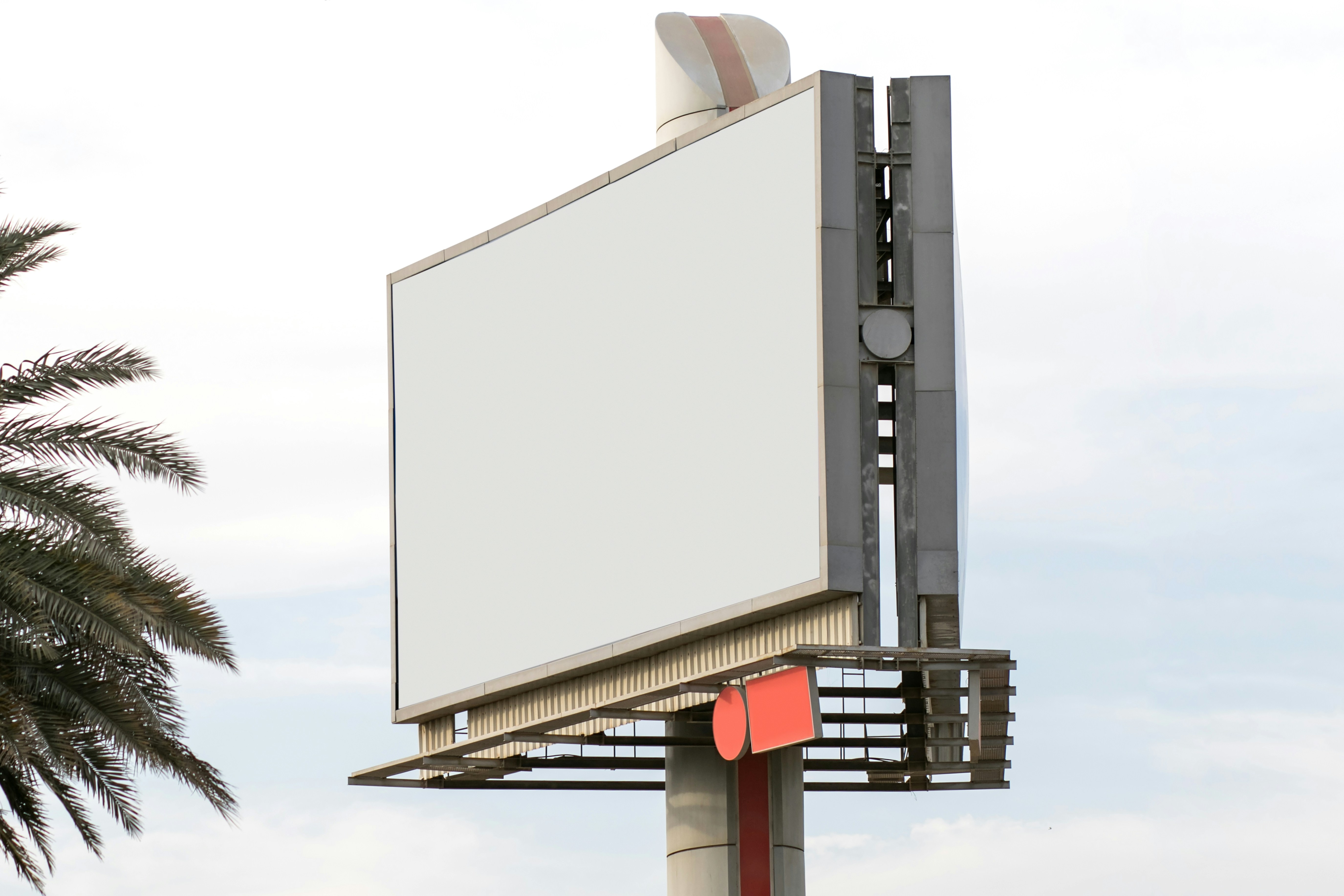
Par un arrêt du 28 octobre 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu’il était possible de cumuler les peines d’affichage, consistant à exposer matériellement la décision de condamnation sur un support physique et de diffusion, visant une publicité élargie par voie de presse ou numérique, d’une décision de condamnation prononcée à l’encontre d’une personne morale. Elle valide ainsi l’interprétation selon laquelle les articles 131-35 et 131-48 du Code pénal autorisent le cumul de ces mesures, tout en rejetant l’argument fondé sur le principe de légalité des peines.
Les faits : un accident du travail à l’origine d’une double peine de publicité
Le 2 mai 2017, un salarié est victime d’un accident du travail résultant d’un manquement à une obligation particulière de sécurité. La société qui l’emploie, reconnue coupable de blessures involontaires, est condamnée à une amende de 50 000 euros, assortie d’une obligation d’afficher la décision au siège social et de la publier sur son site internet pendant deux mois.
Au soutien de son appel, la société prétend que la loi n’autorise pas le cumul de ces deux peines complémentaires. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 6 septembre 2024, confirme néanmoins la condamnation.
La question de la légalité du cumul des peines d’affichage et de diffusion
Devant la Cour de cassation, la société invoque, pour contester la décision de la cour d’appel, la violation du principe de légalité des délits et des peines, consacré par l’article 111-3 du Code pénal, selon lequel nul ne peut être condamné pour un fait non prévu par la loi ni puni d’une peine qu’elle ne prévoit pas expressément.
Pour elle, la cour d’appel a excédé son pouvoir de sanction en prononçant deux mesures là où le texte n’en vise qu’une seule. Elle considère que, conformément à la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article 222-21 du Code pénal, applicable aux blessures involontaires, lequel renvoie à l’article 131-39, 9°, pour les peines applicables aux personnes morales, cet article ne prévoit que « l’affichage ou la diffusion » de la décision. L’emploi de la conjonction « ou » doit donc, selon la société, exclure toute possibilité de cumul et interdire la double publicité ordonnée par les juges du fond.
L’application de la loi 2011-525 autorisant le cumul des peines d’affichage et de diffusion
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le régime des peines applicables aux personnes morales est fixé par l’article 131-48 du Code pénal, lequel renvoie aux conditions de l’article 131-35. Or, depuis la loi 2011-525 du 17 mai 2011, ce texte autorise expressément le cumul de l’affichage et de la diffusion.
Ainsi, en décidant la publication simultanée au siège social et sur le site internet de la société, la cour d’appel n’a pas excédé ses pouvoirs, mais appliqué correctement les textes en vigueur. En outre, si l’arrêt mentionne, de manière erronée, l’article 131-38 du Code pénal au lieu de l’article 131-48, cela représente seulement une inexactitude matérielle qui n’affecte pas la portée juridique de la décision.
Une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation
La solution adoptée marque une évolution notable de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, par le passé, a retenu une interprétation plus restrictive des textes.
Dans un arrêt du 7 février 2006 (n° 05-80.083), la Chambre criminelle avait estimé que la peine d’affichage et celle de diffusion étaient exclusives l’une de l’autre, l’emploi de la conjonction « ou » dans l’article 131-39 ne permettant pas leur cumul, position réitérée par un arrêt du 23 juin 2015 (n° 14-80.213), où la Cour avait considéré que le juge ne pouvait prononcer qu’une seule de ces mesures de publicité.
L’arrêt du 28 octobre 2025, en s’appuyant sur la rédaction issue de la loi du 17 mai 2011, consacre désormais la possibilité d’un cumul, estimant que cette évolution législative a expressément levé l’ambiguïté antérieure. La Cour adopte ainsi une lecture du texte, orientée vers la transparence et la responsabilisation des entreprises.
Une décision confirmant la volonté du juge de responsabiliser les entreprises
Conformément aux principes inspirant les règles de compliance et notamment le devoir de vigilance, la Cour de cassation tend, par cette décision, à obliger les entreprises sanctionnées pénalement à diffuser largement cette information dans une logique de « name and shame ». Si, en validant le cumul des peines de publicité, cette décision renforce la portée dissuasive et symbolique de la condamnation, elle risque toutefois d’en accentuer la sévérité pratique.
Pour les entreprises, cette interprétation des textes répressifs peut soulever des interrogations sur la proportionnalité des mesures de publicité, notamment lorsqu'elles s’ajoutent à des amendes significatives. Si l'objectif de transparence poursuivi par le législateur ainsi que la volonté du juge de responsabiliser les entreprises demeurent légitime, la solution retenue appelle à une vigilance accrue dans la défense des personnes morales, afin d'éviter que la sanction n'entraîne une atteinte disproportionnée à leur image ou ne mette en péril leur activité économique.





